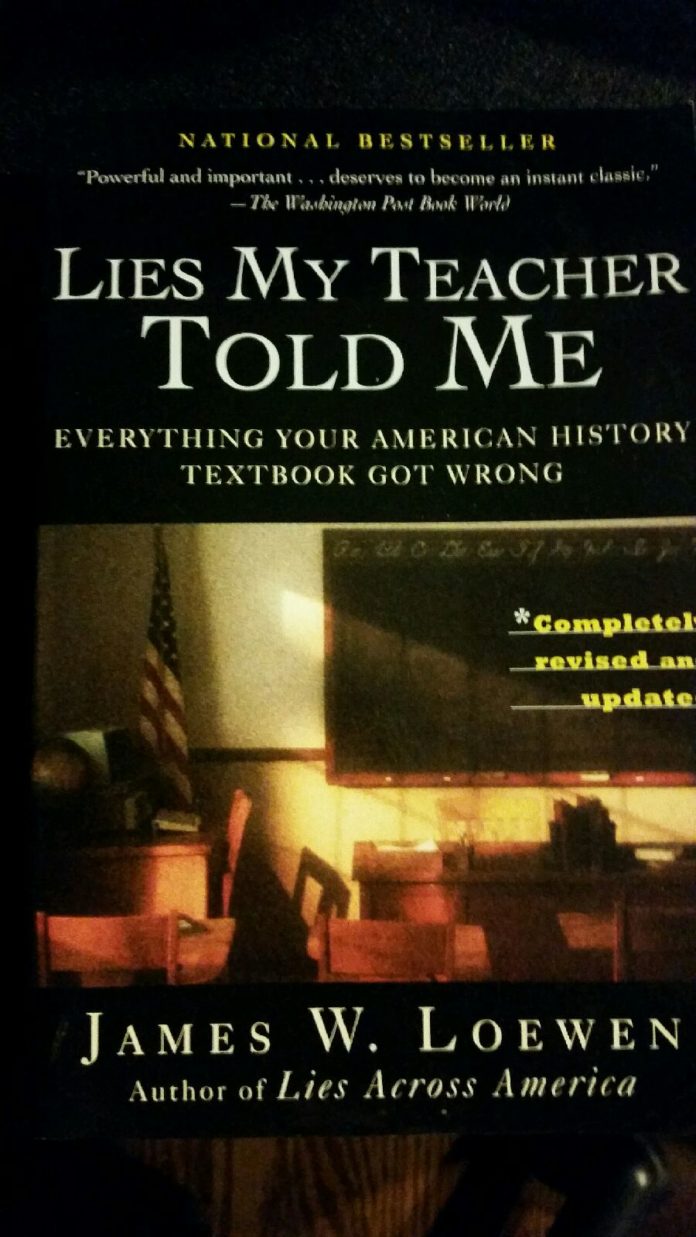
Nous sommes le jeudi 22 juin. Je passe déposer ma voiture chez mon garagiste, en face de l’hôpital où j’ai longtemps travaillé. Ce sont les freins qui méritent d’être ajustés ou changés. Je n’en sais rien sauf que je vais ronger mes freins pendant environ deux heures, le temps pour le mécanicien de s’occuper de la bagnole. Je m’irrite, je m’emporte, je m’échauffe, je m’emballe, je peste, je rouspète, je tempête, je me déteste, car je réalise que je vais passer deux heures sinon davantage à me tourner les pouces, à éplucher des wès, à caler des wès. Je suis peut-être l’homme le plus paresseux du monde, mais je n’ai jamais été un oisif, je suis plutôt du genre paresseux actif. Me voilà donc debout dans la rue, sous un arbre, en face de l’établi du garagiste qui n’a même pas un ti akwoupi de salle d’attente pour ses clients.
Après avoir consulté les quatre points cardinaux (et les dieux) et m’être demandé que faire, je me suis souvenu de l’existence d’une bibliothèque municipale tout près, à deux coins de rue de mon garagiste. Soudain, je me suis senti heureux, épanoui, apaisé, soulagé, réconforté, revigoré, regonflé, revivifié, requinqué, à la pensée que j’allais pouvoir commencer à préparer ma prochaine rubrique feuillante. Il est onze heures trente. Je prends la route sous un soleil assez ardent. J’arrive devant la biblio à onze heures quarante. Surprise. Une petite affiche m’annonce que le local – en principe ouvert – est fermé jusqu’à deux heures pour “délibérations administratives”. Koubabiston!
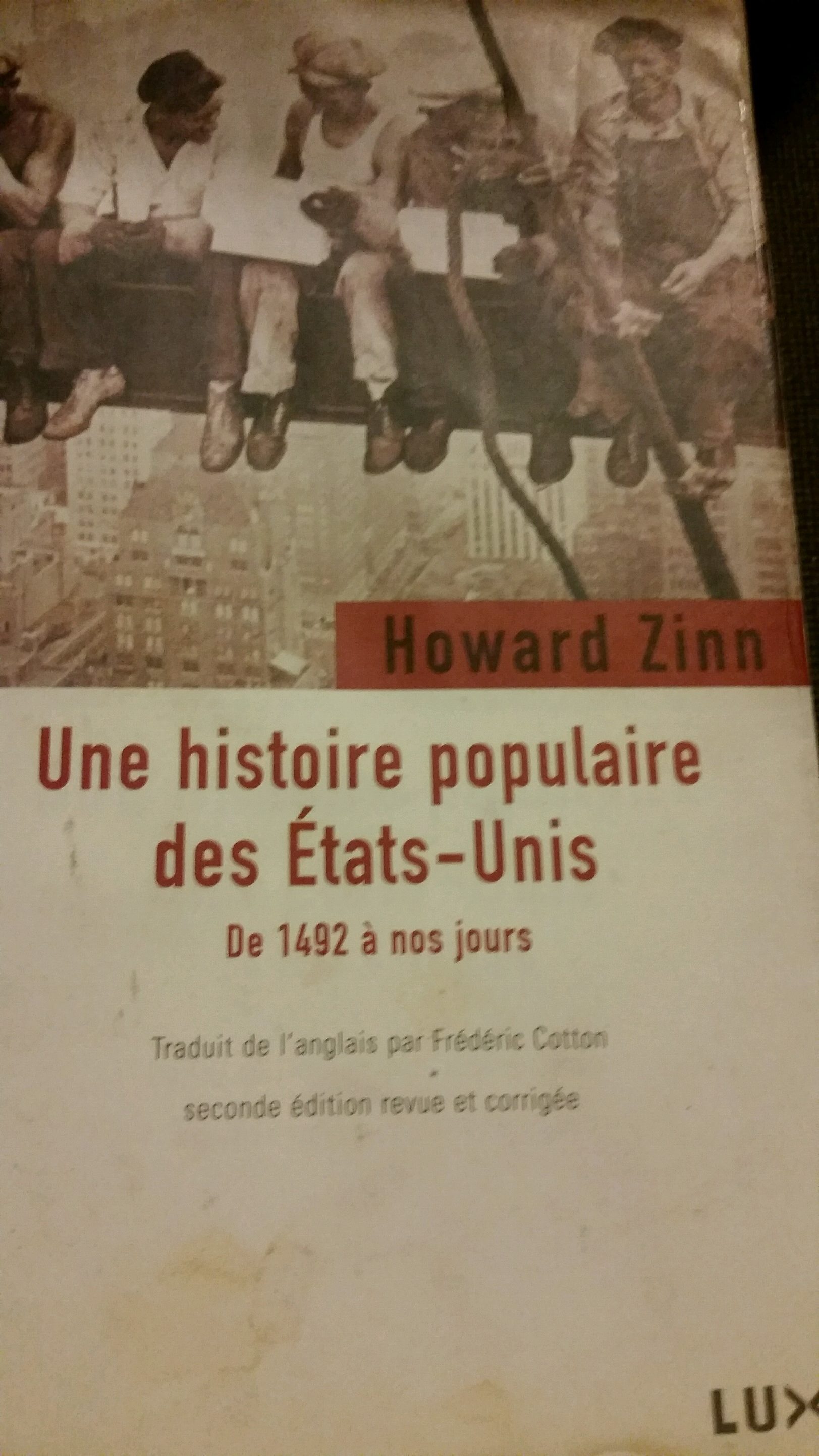
Je manque de m’évanouir. Comme disent les Québécois, “je prends un grand respire” pour apporter un supplément d’oxygène à mon cerveau. Je reprends mes sens. Je me dis que si au moins j’avais une feuille de papier je pourrais commencer à écrire. De tous côtés, je ne vois aucun magasin qui pourrait venir à mon aide. Miracle! Sur le trottoir traîne un bout de papier, une fiche de paiement dont le verso est vierge. En face de la biblio, il y a un McDonald. Je me dis que je vais m’y abriter. Tout de suite, je me sens transporté, inspiré, exalté, enflammé, emballé, enthousiasmé. Menm vole mwen t a vole. Mais voilà qu’au moment de passer la porte du resto Macdo, je m’aperçois que je n’ai pas de plume. Miséricorde! M fini.
Je ressens ma finitude comme une déchéance, une dégringolade, une indignité, une flétrissure, une humiliation. Imaginez: un intellectuel, un chroniqueur dans un journal (de gauche, s’il vous plaît), un déshabilleur de politiciens véreux, un habilleur de militants et révolutionnaires conséquents, un ti landeng fréquemment dans le fifre d’une bourgeoisie patripoche, un briseur d’images et d’idées reçues véhiculées par une presse aux ordres, un pitit Desalin, un héritier de Lénine, un homme de plume ki pa nan lalin, voilà qu’il se promène sans même une plume avec lui. Le voilà déplumé. Je me suis alors senti intellectuellement, psychologiquement toutouni. Quelle pitoyable toutounitude!
Je m’affale à une table, tête baissée. Heureusement que je suis le seul à vivre mon malaise, mon vide intérieur. Personne du journal n’en saura rien, les lecteurs encore moins. Mais, il y a autour cette femme qui nettoie le plancher. Elle a dû sans doute remarquer ma prostration depuis une bonne demi-heure. Elle s’approche de ma solitude, décrépitude et finitude, me tèque gentiment à l’épaule: monsieur, ça va? Vous semblez cuire un gros chagrin. Chagrin d’amour? Risque-t-elle. Non, chagrin d’écriture, que je lui réponds. Mais alors, mal exprimé en anglais, mon mal passe mal. Manmzèl ne comprend pas, et tout en s’éloignant, elle me glisse: take care, prenez bien soin de votre chagrin. Konnen l pa konnen.
Alors que j’essaye de me refaire le visage en relâchant mes muscles faciaux, particulièrement l’orbiculaire des lèvres et l’orbiculaire de l’oeil, je vois entrer une dame dont le visage me dit qu’elle est une jeune septuagénaire. Manifestement, elle me regarde et même me fait un demi-sourire complice. Ne sachant pas où je suis garde avec elle, je lui retourne seulement un quart de sourire. Résolument, elle marche vers moi, un plein sourire de connivence aux lèvres: je vous connais, je vous reconnais, ne vous souvenez-vous pas de moi? Ne sachant pas vraiment quoi répondre, et pou m pa ba l manti, je lui fais maintenant un demi-sourire .
Manmzèl s’approche. Puis-je partager votre table? Bien sûr, san m pa ba l manti.
– C’est bien le docteur Latour, le pathologiste, n’est-ce pas? Vous aviez l’habitude de venir fréquemment pour l’examen extemporané de pièces chirurgicales. Vous aviez l’air si cool, si relax.Vous passiez invariablement devant mon bureau. Vous me gratifiez d’une rapide risette. Je contrôlais les patients qui arrivaient en salle d’opération et vérifiais leur identification et leur dossier médical avant de les envoyer aux chirurgiens qui tripatouillaient l’en-dedans de leur ventre. Vous vous souvenez, n’est-ce pas?
– Mais bien sûr que je m’en souviens. Tenez, c’est comme rebobiner un film au ralenti. Voilà, je me rappelle, vous aviez cette originalité de marcher avec des sabots qui ne faisaient pourtant pas de bruit.
Je n’ai pas osé lui dire, en anglais bien sûr, qu’elle portait plutôt des sabotines. Mon truc de “mal d’écriture” avait déjà été un flop, je n’ai pas voulu récidiver pour ne pas saboter le plaisir de ces retrouvailles tout en sabotinettes.
– Et puis, doc, vous avez disparu de mon horizon. J’ai ensuite appris que vous quatre en pathologie, vous aviez été mis à pied, remercié par l’Université qui avait acheté l’hôpital. J’ai compris que la direction avait recruté deux jeunets, deux gringalets, deux freluquets, deux marmousets pour dix fois moins d’argent qu’on vous payait les quatre qui aviez plus d’expérience. Moi aussi, j’ai été victime du downsizing (réduction des effectifs), une manœuvre sentant les pratiques capitalistes à cent lieues à la ronde.
Alors là, je suis revenu vraiment à la vie. D’un coup, la conversation devient intéressante, je commence à sentir où je suis garde avec elle. Je lui demande de me rappeler son nom:
– Cynthia… Oui, doc je ne sais pas ce vous pensez de ce système dans lequel nous vivons, mais c’est révoltant. Après vingt-cinq ans de loyaux services, on vous fout à la porte. Vous n’avez même pas une pension décente. Imaginez, mon mari est un vétéran de la guerre du Koweit. C’est un éclopé, un mutilé de guerre, avec ses deux jambes coupées, un œil fauché et une surdité qu’aucun appareil auditif ne peut aider. Oh! le système capitaliste pue (stinks).
J’étais au lycée quand Dad me l’a recommandé après en avoir parlé à mon prof d’histoire qui a failli s’étrangler de tant de mensonges que véhiculent les cours d’histoire. À l’école, je ne tenais pas ma langue dans ma poche et à l’occasion je leur disais leurs quatre vérités, toutefois sans esprit de provocation.
Alors là, je me sens dans mon plat. Je sors ma belle argenterie politique et me vois bien à table, découpant, fourchettant “le système”. Mais je suis troublé par les propos de cette femme et veux chercher à savoir à quelle fontaine elle a bu cette eau rafraîchissante qu’elle versait sur la tiédeur de mon quart de sourire. Alors, je risque une fourchettée;
– Dites donc, Cynthia, pour une américaine native-natale baignant depuis l’enfance dans les eaux stagnantes du capitalisme, je suis très surpris, je trouve que vous tenez des propos assez osés comme ça, vous êtes l’exception en la matière; éclairez donc ma lanterne…
– C’est vrai que j’ai un peu faim, mai je ne vais pas tout de suite écourter cette conversation. Je ne suis pas toutefois la seule exception. Loin s’en faut. Laissez-moi vous expliquer. A la vérité, mes flèches et fléchettes lancées au hasard de mes frustrations quand je travaillais à la salle d’opération peuvent avoir contribué à ma mise à pied, je n’en sais rien. C’est une assez longue histoire.
– Oui, give me, ban m non, donne-moi donc.
– Mon père était un mécanicien, membre du syndicat des cheminots de Chicago dont je suis originaire. Ma mère tenait un salon de coiffure. Nous étions quatre à la maison. Dad (Papa) avait l’habitude d’expliquer des tas de choses à Monm (Maman) qui écoutait de façon distraite, mes trois frères aussi. Moi, je suivais attentivement. Il lui arrivait souvent de parler de Howard Zinn, vous le connaissez?
– Bien sûr. En fait, j’ai la traduction française de son livre clé A People’s History of the United States (Une histoire populaire des États-Unis). C’est un classique. Contrairement à Colomb, j’ai vraiment découvert l’Amérique; l’Amérique d’un point de vue de la lutte de classes, du racisme connexe à la marginalisation-élimination des Amérindiens. Oui, je connais bien Zinn.
– Mon père s’échauffait quand il parlait de Zinn dont il rappelait souvent une visite qu’il avait faite à Chicago où il s’était entretenu avec les cheminots au sujet de la guerre du Vietnam. Au salon trônait seulement deux grandes photos, l’une de Zinn, l’autre de ma mère. Dad était un autodidacte qui comprenait bien le système. Il ne me l’a jamais expliqué comme tel, mais c’est par osmose, si je puis dire, que j’ai appris bien des choses de lui.
– En passant, avez-vous lu le livre de l’histoire populaire des états-Unis par Zinn?
– Ça a été mon livre de chevet. Mais avant de le lire, mon père m’avait introduit à la lecture d’un livre par James Loewen. Le titre de l’ouvrage: “Lies my teacher told me” (Mensonges que m’a débités mon professeur). Justement, Howard Zinn en avait fait un élogieux commentaire. J’étais au lycée quand Dad me l’a recommandé après en avoir parlé à mon prof d’histoire qui a failli s’étrangler de tant de mensonges que véhiculent les cours d’histoire. À l’école, je ne tenais pas ma langue dans ma poche et à l’occasion je leur disais leurs quatre vérités, toutefois sans esprit de provocation.
– Vous m’en avez raconté des choses, Cynthia, en un laps de temps aussi court. Qu’est-ce que vous faites maintenant?
– Je suis aide-coiffeuse dans un salon presque en face du resto. Je me débrouille. Je n’ai plus l’âge de mes trente ans. Rester debout parfois plus de huit heures de temps, à mon âge, ce n’est pas gai. Parfois, j’ai les jambes qui enflent un peu, mais je tiens quand même le coup. Et vous?
– J’ai contribué à mettre sur pied un Haitian Community Center of Philadelphia où j’ai fonctionné comme, disons, à la fois directeur exécutif et employé de chaque jour, à titre bénévole. Je tiens depuis plusieurs années un Bulletin, un newsletter trimestriel destiné aux camarades de promotion. Histoire de garder le contact. En octobre nous comptons célébrer, à Savannah, un cinquante-cinquième anniversaire. Depuis 1989, je tiens une ou deux rubriques dans les journaux. D’abord à un premier hebdomadaire progressiste, “Haïti Progrès”. Avec trois autres camarades politiques issus de “Haïti Progrès“, nous avons fondé “Haïti Liberté”, en 2007. J’en suis le rédacteur. Haïti Liberté est un journal de gauche, essentiellement politique, anti-impérialiste, anti-capitaliste, résolument attaché à une compréhension de nos sociétés à travers une grille marxiste-léniniste de lutte de classes. Je passe mes heures creuses (j’en ai très peu) à rêver aux “lendemains qui chantent”.
– Bravo! Mon père aurait été heureux de le savoir. En fait, c’est cette histoire de capitalisme et de mon mari éclopé qui entretient notre conversation. Je dois dire que mon mari est mort, finalement, faute de couverture médicale et de soins adéquats que le système médical pour les vétérans de guerre ne lui a pas fournis. Vous voyez, beaucoup de ces types que vous rencontrez avec un petit carton en main “Help, I am hungry”, ce sont des “vets”, des vétérans que le système a jetés littéralement dans les rues comme des torchons après s’en être servis. Je vous dis que le capitalisme, it stinks, oui, il pue.
– Ah oui, je le sais aussi bien que vous. Un ancien président de mon pays disait alors qu’il était encore un prêtre: kapitalis se peche mòtèl.
– Vous parlez de monsieur Aristide. C’est quoi la traduction?
– Capitalism, a mortal sin.
– C’est sûrement vrai. Voyez, il a accouché d’un minable et dangereux Donald Trump après avoir couvé pendant longtemps a mother f... (Doc, excusez-mon langage châtié), aussi dangereuse que l’actuel président… Ma parole, Doc, on a bien parlé; voyez, il est presque deux heures. Je dois retourner travailler. Laissez-moi croquer en vitesse un burger et un soda. Je fais un p’tit boulot tout près. Je ne peux pas me permettre d’être en retard. Votre Aristide avait raison: capitalism, a mortal sin.
– Cynthia, je file à la biblio. J’ai eu grand plaisir à vous revoir. Merci pour les intéressantes confidences. Voilà que j’ai longtemps côtoyé sans le savoir une âme sœur, une âme politique sœur. Il est capital, ma sœur, qu’on ait le capitalisme à l’œil, parce qu’avec son œil torve, il voit tout de travers. Je vous glisse mon numéro de téléphone. Restons en contact.
Après avoir pris congé de Cynthia, je me suis vite engouffré dans la bibliothèque, j’ai sauté sur le seul ordinateur disponible et c’est ainsi que j’ai pu concocter le profil des “feuilles” de cette semaine pour vous les servir bien arrangées en une gerbe anticapitaliste, “à la mode de chez nous” à la mode de Latulipe.
22 juin 2017










