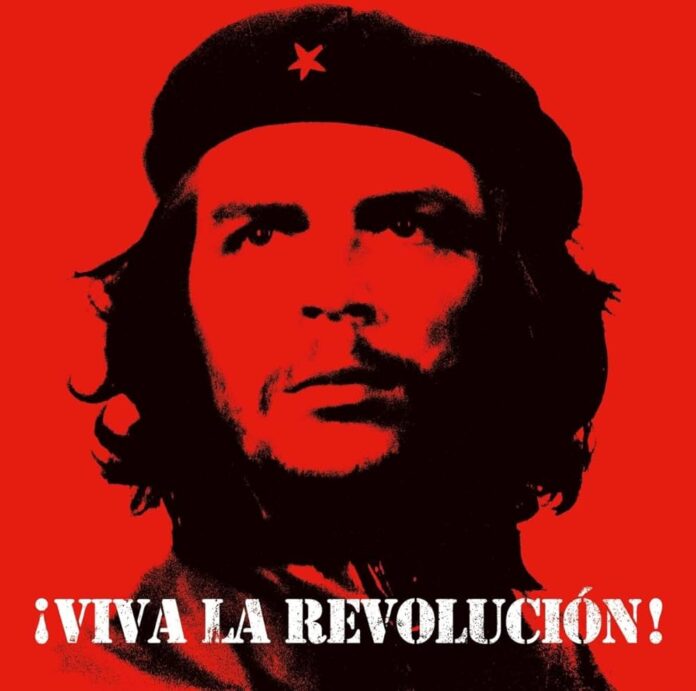
(English)
Toute société se définit par ce qu’elle autorise à être dit et par ce qu’elle interdit à être pensé. Lorsque la parole est confisquée, lorsque des individus ou des groupes sont empêchés d’exprimer leur version de l’histoire, la violence devient inévitable.
Comme le rappelle Hannah Arendt, dans Du mensonge à la violence, la violence surgit précisément lorsque l’espace de la parole et de l’action politique est fermé. Donc, interdire le langage, c’est nourrir l’explosion.
L’histoire de la pensée politique nous enseigne que là où la vérité est niée, la révolte prend racine. Mais une révolte sans vérité et sans structure ne devient pas révolution : elle dégénère en chaos. L’histoire d’Haïti, depuis son indépendance, est traversée par une tension permanente entre révolte populaire et capture institutionnelle. Ce qui est souvent nommé « chaos » par les diplomates et les élites n’est pas une fatalité culturelle, mais le produit d’une histoire d’étranglement structurel : interventions étrangères, élites compradores, économie criminelle protégée.
cette violence ne devient féconde que lorsqu’elle est canalisée dans un projet collectif.
Au cœur de cette crise multidimensionnelle, une confusion majeure règne : on confond rébellion, insurrection, violence et révolution. On confond tout en Haïti. Et ce brouillard est entretenu volontairement : il permet de criminaliser la contestation et de neutraliser toute alternative.
Autrement dit: Cette confusion, entretenue par les puissances et les élites, empêche de distinguer ce qui relève d’un cri brut de désespoir et ce qui incarne un projet de transformation politique enraciné. Tout commence par une distinction simple : Violence. Rébellion. Insurrection. Révolution.
Violence : un cri brut, aveugle, langage ultime des humiliés, c’est-à-dire, de ceux à qui on a volé la voix. Une explosion désordonnée de colère. La violence est un instrument, jamais une fin politique en soi. Elle traduit une incapacité à faire émerger un espace de parole et de représentation (Arendt). Dans le cas haïtien, les quartiers populaires recourent à la violence comme un langage ultime face à un État capturé, une justice sélective et une diplomatie étrangère qui nie leur humanité.
Frantz Fanon, dans Les damnés de la terre, montre que la violence peut être libératrice lorsqu’elle détruit les structures coloniales qui enferment l’homme dominé. Mais cette violence ne devient féconde que lorsqu’elle est canalisée dans un projet collectif. Sinon, elle s’effondre dans la spirale des règlements de compte.
Maintenant la rébellion : un refus. Elle dit NON à l’humiliation, à la faim, à l’injustice. Mais elle n’a pas encore de projet. Elle brise le consentement mais reste fragmentaire. Albert Camus, dans L’Homme révolté, distingue la révolte comme affirmation existentielle du “non”.
Le rebelle dit : « Je ne peux plus supporter ceci. » Il se dresse, non par programme politique, mais par dignité. La révolte peut libérer ou détruire selon qu’elle s’accompagne ou non d’une vision. Sans vérité structurée, la révolte se dissout en nihilisme.
Dans le contexte haïtien, la rébellion est l’expression de l’intolérable : faim, humiliation, marginalisation. Elle n’est pas organisée, mais elle brise le consentement. Nietzsche éclaire cette posture par sa critique de la morale esclavagiste (Généalogie de la morale). La rébellion haïtienne n’est pas nécessairement noble : elle est d’abord un cri contre l’écrasement. Elle peut rester fragmentaire, mais elle ouvre une brèche dans le mur de la résignation.
L’insurrection, pour sa part, dépasse la rébellion. C’est collectif. C’est le peuple qui se lève. Elle suppose la constitution d’une force sociale qui renverse l’ordre établi, sans toujours posséder une vision structurée de l’après. Et sans vision, elle dégénère en anarchie désorganisée et ouvre la porte aux récupérateurs. (Sartre, Bakounine).
Sartre, dans Critique de la raison dialectique, montre que l’insurrection peut émerger de la fusion des subjectivités dans l’action. Mais si cette fusion n’est pas articulée à une pensée de l’avenir, elle débouche sur une anarchie désorganisée.
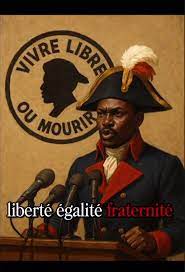
Bakounine, lui, voit dans l’insurrection un moment nécessaire : la destruction des structures oppressives. Mais il avertit : sans auto-organisation populaire, l’insurrection peut être récupérée par de nouvelles élites. Le vide ne dure jamais. Là où l’État capturé laisse s’installer le chaos, il se présente ensuite comme le seul garant d’ordre — justifiant encore plus de répression. C’est précisément le drame haïtien : chaque insurrection populaire est confisquée par des transitions imposées, produisant une continuité de la servitude.
La révolution, c’est autre chose. C’est un projet enraciné. C’est l’art de transformer la rage en organisation, le refus en avenir, le chaos en refondation. Autrement dit: la Révolution = transformation structurée, enracinée dans une vérité partagée et une organisation claire. La révolution se distingue radicalement de la rébellion, de la violence et de l’insurrection. Elle suppose non seulement un refus, mais une construction d’un nouvel ordre symbolique, politique et économique (Fanon, Arendt).
Fanon montre que la révolution anticoloniale n’est pas qu’un changement d’élites, mais une refondation totale de l’homme et de ses institutions. La révolution de 1804 fut l’unique moment de ce type en Haïti : un renversement radical de l’ordre mondial, une affirmation universelle de liberté.
Arendt rappelle que la révolution véritable instaure un espace de liberté durable, où le peuple se représente lui-même. Or, depuis deux siècles, Haïti vit dans la caricature : des révoltes confisquées, des insurrections détournées, une violence sans projet.
Pourquoi la vérité est centrale?
Parler avec ceux que le système appelle “ennemis” ou “bandits” est indispensable. Inutile de dire, les exclus, il faut écouter même les voix jugées illégitimes, et ce n’est pas céder — c’est ouvrir l’espace de vérité qui seule peut transformer la révolte en révolution. C’est empêcher que leur frustration, leur rage et leur sentiment d’exclusion ne se transforment en nihilisme destructeur. Sans parole, il n’y a que balles. Sans organisation populaire, il n’y a que récupération. Sans projet enraciné, il n’y a que chaos. Et ce chaos, devinez qui en profite ? Pas le peuple. Mais ceux qui tiennent l’économie criminelle.
Car la vérité, dans sa brutalité, vaut mieux que la propagande. La vérité est dangereuse, certes. Mais l’absence de vérité est fatale. Pourquoi ? Parce que la parole libère ce que le silence enferme : frustration, rage, injustice, et sentiment d’exclusion. La parole est plus qu’un droit : elle est un mécanisme de pacification. Refuser la parole à ceux qui se sentent exclus, c’est confisquer la seule arme qui canalise la rage en langage.
L’existentialisme politique, comme le dirait Sartre, consiste à assumer que chaque choix — parler, écouter, ignorer, réprimer — crée le monde que nous habitons. Inutile de dire, c’est un acte fondateur. Ne pas écouter, c’est choisir la violence. Écouter, c’est ouvrir la voie d’une révolution lucide.
Le silence imposé aux voix dissidentes mène directement à une anarchie incontrôlée qui ne profite qu’aux forces dominantes, jamais au peuple. Michel Foucault l’a bien montré : chaque système de pouvoir produit sa propre dissidence. Là où l’expression est réprimée, la résistance se déplace vers la clandestinité, puis vers la violence.
Le simple fait de dialoguer, même avec ceux que l’on étiquette “bandits”, n’est pas une légitimation de leurs actes — c’est un mécanisme de prévention de l’explosion. Ne pas leur permettre de verbaliser leur vision du monde, c’est précipiter le pays dans une spirale insurrectionnelle.
Et si on continue à imposer le silence et à confondre la parole des exclus avec une menace, on n’aura pas une révolution — on aura l’anarchie totale, un chaos désorganisé, qui ne servira qu’à renforcer ceux qui tirent déjà les ficelles.
C’est précisément pourquoi les puissances étrangères confondent volontairement « violence » et « révolution », afin de criminaliser toute contestation. Elles présentent les rebelles comme « terroristes », les insurgés comme « criminels », afin d’empêcher l’émergence d’un projet de transformation.
Foucault, dans Surveiller et punir, éclaire cette logique : le pouvoir transforme la contestation en déviance pour mieux la neutraliser. Quand on interdit à une partie de la société de raconter sa version de l’histoire, quand on les réduit au silence, la seule issue qui reste, c’est la violence. Et c’est précisément là que l’on bascule dans l’insurrection désordonnée, dans la rébellion chaotique.
On nous dit : « Les gangs sont le problème. » Non. Le vrai problème, ce sont les élites compradores et les puissances étrangères qui capturent l’État, imposent des transitions, affament le peuple, et criminalisent toute contestation.
L’essentiel n’est pas de nier la rage populaire, mais de la transformer en un projet enraciné de refondation.
On nous dit : « La sécurité d’Haïti est importante pour les États-Unis. » Mensonge. Leur vraie sécurité, c’est la continuité de leur domination. On nous dit : « Ne parlez pas avec eux. » Mais refuser le dialogue, c’est pousser les damnés vers la seule issue qu’il leur reste : la violence.
La clé est donc dans la vérité. Car si nous ne comprenons pas les mécanismes et les codes que les agents du système ont utilisés pour capturer l’État et le transformer en machine criminelle, alors toute révolte ne fera que nourrir plus de chaos.
Posons-nous les vraies questions :
- Dans ce chaos, qui gagne?
- Est-ce le peuple ? Non.
- Est-ce que le peuple est représenté? Non.
- Où est l’organisation qui parle au nom du peuple réel face à un État capturé? Elle reste à bâtir.
Notre tâche est:
- Dire la vérité, même quand elle dérange.
- Ouvrir un espace de parole pour que la rage devienne conscience.
- Transformer la rébellion en révolution.
- Construire l’organisation qui représentera le peuple contre l’État capturé
Nietzsche affirmait : « Les vérités qui ne sont pas dangereuses méritent à peine d’être appelées vérités » (Par-delà bien et mal, 1886). Or, le problème d’Haïti aujourd’hui n’est pas l’absence de discours, mais l’absence de vérité.
La vérité dont Haïti a besoin n’est pas morale, mais structurelle : il faut dévoiler les mécanismes précis qui ont permis la capture de l’État. Si l’on ne dévoile pas les mécanismes et codes qui ont permis aux agents du système de capturer l’État et de le transformer en appareil criminel, alors la révolte se fera dans le brouillard. Et comme l’enseignait Sartre, “agir sans lucidité, c’est prolonger sa servitude.”
- Comment l’élite économique et politique a transformé l’État en machine de rente.
- Comment la communauté internationale a imposé des transitions illégitimes.
- Comment sanctions, ONG et “humanitarisme” sont devenus des instruments de domination.
Sans ce dévoilement, comme le dit Foucault, nous restons prisonniers d’un “régime de vérité” imposé, et toute révolte sera aveugle.
En conclusion, la révolution haïtienne ne pourra renaître qu’en dépassant la confusion entretenue entre violence, rébellion, insurrection et révolution. L’essentiel n’est pas de nier la rage populaire, mais de la transformer en un projet enraciné de refondation. La vérité doit être dite : les mécanismes du système — sanctions arbitraires, transitions imposées, criminalisation des pauvres — alimentent le chaos. Ne pas le reconnaître, c’est condamner Haïti à l’anarchie perpétuelle.
La tâche des intellectuels et des citoyens lucides n’est pas de juger la rébellion, mais de l’éclairer, de lui donner un horizon. Car sans organisation populaire et sans un projet enraciné, la rébellion ne sera jamais révolution.
La question reste donc entière : Voulons-nous une révolution fondée sur la vérité, ou un chaos désorganisé qui ne servira qu’aux maîtres du système?









